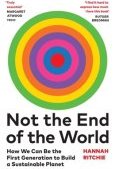Ne pas confondre contamination et pollution
Publié en ligne le 25 avril 2024 - Environnement et biodiversité -
Contamination et pollution sont deux notions scientifiques différentes et savoir les distinguer a beaucoup d’importance dans le débat public.
La contamination est caractérisée par la présence d’une ou de plusieurs substances chimiques dans un sol du fait des activités humaines [1]. Cette définition exclut une origine naturelle, provenant par exemple de substances déposées suite à une éruption volcanique ou héritées de la composition chimique du matériau géologique ayant participé à la formation du sol.
La pollution correspond, elle, à un préjudice causé par les substances présentes dans le sol sur son fonctionnement et en particulier sur les organismes qui y vivent [1]. Le lien entre contamination et pollution n’est donc pas systématique. Sans mise en évidence d’un effet préjudiciable, une contamination ne peut être considérée comme une pollution. À l’inverse, une pollution d’origine naturelle ne peut être considérée comme une contamination, cette dernière étant nécessairement d’origine anthropique.

Cette distinction s’inscrit dans le fondement même de la démarche d’évaluation des risques liés à une contamination du sol. Elle permet d’éviter de classer a priori des pratiques pouvant être considérées au sens strict comme contaminantes, mais qui ont des effets intentionnellement positifs sur l’utilisation que nous faisons du sol, avec celles qui ont au contraire des effets délétères. C’est notamment le cas des nombreuses pratiques agricoles qui visent à améliorer la fertilité du sol en l’enrichissant par l’apport de matières organiques (fumiers, lisiers, composts...) ou minérales (engrais de synthèse azotés ou phosphorés) et qui constituent donc par définition une « contamination ». Pourtant, si certaines de ces pratiques peuvent occasionnellement avoir des effets préjudiciables, la majorité d’entre elles améliorent au contraire le fonctionnement du sol de telle sorte qu’il n’est, le plus souvent, pas pertinent de parler de pollution. Faire la distinction entre contamination et pollution permet également de hiérarchiser la gestion des sols contaminés en ciblant les situations les plus problématiques pour lesquelles une toxicité sur l’être humain ou les organismes du sol a été factuellement mise en évidence.
Toutefois, une contamination peut être le signe avant-coureur d’une pollution à venir dont les conséquences délétères ne sont pas encore mises en évidence ou masquées temporairement par les capacités de résistance et de résilience du sol.
Les sols, réceptacles à contaminants
Pour prévenir une pollution du sol, il convient tout d’abord d’appréhender le niveau de sa contamination. Cette dernière résulte d’une perturbation du cycle biogéochimique d’une ou plusieurs substances, naturelles ou de synthèse, par les activités humaines [2]. Le cycle biogéochimique désigne l’ensemble des processus cycliques de transport et de transformation d’un élément ou d’une molécule entre les différents compartiments de l’environnement que sont l’air, l’eau, le sol, le sous-sol et les êtres vivants. On parle ainsi des cycles du carbone, de l’azote, de l’eau, etc.
Dans le contexte qui nous intéresse ici, cette perturbation correspond à un blocage au niveau du sol et à plus ou moins long terme du transfert de ces substances vers les autres compartiments de l’environnement. Les apports de contaminants (par exemple par les fertilisants ou les produits phytosanitaires) deviennent supérieurs à la capacité du sol à les faire circuler vers un autre compartiment (par exemple vers la ressource en eau par érosion à la surface du sol ou vers la biosphère par le prélèvement par les plantes). Ce phénomène doit se produire sur une échelle de temps perceptible par l’être humain pour que la contamination soit caractérisable, soit de quelques mois à quelques décennies. Cela se traduit concrètement par un bilan excédentaire du contaminant et en conséquence par son accumulation dans le sol.

Ces perturbations des cycles biogéochimiques sont bien décrites pour les éléments chimiques majeurs tels que l’azote et le phosphore, avec de sérieuses conséquences en matière d’eutrophisation des eaux douces et marines, correspondant à un enrichissement en matières nutritives qui provoque la prolifération de certaines algues [3, 4]. Elles ont également été décrites plus récemment pour des contaminants émergents comme les plastiques [5].
Ces accumulations sont particulièrement marquées dans les sols dont la porosité agit, à l’image d’un tamis, comme un filtre physique, alors que la réactivité de la matière organique et des minéraux (comme les argiles par exemple) joue, à l’image du charbon actif d’une bonbonne d’eau, un rôle de filtre chimique. On comprend dès lors que les propriétés physiques et chimiques intrinsèques du sol en font un excellent réceptacle des contaminants émis dans l’environnement.
La biodisponibilité, déterminant clé de la pollution
Pour caractériser l’existence d’une pollution dans un sol contaminé, les scientifiques s’appuient sur la notion de biodisponibilité (voir le premier encadré). Selon cette dernière, seule une fraction de la concentration totale d’un contaminant est susceptible d’être absorbée par les organismes vivants pour ensuite s’y accumuler et avoir de possibles effets préjudiciables. Ces organismes incluent la faune microscopique et macroscopique (vers de terre, nématodes…), les micro-organismes (bactéries et champignons), les plantes dont les racines se développent dans le sol. Il s’agit aussi des êtres humains qui peuvent être exposés directement aux contaminants du sol par ingestion ou contact avec des particules, ou indirectement par la consommation d’aliments préalablement contaminés.
On parle alors de la fraction « biodisponible » du contaminant dont la caractérisation repose sur trois critères : la disponibilité du contaminant dans le sol, son absorption par un ou plusieurs organismes et, enfin, son accumulation dans les tissus pouvant entraîner des effets toxiques.
Les bases de la théorie de la biodisponibilité semblent avoir été posées dès le XIXe siècle par l’agronome et chimiste français Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887) [1]. Si près de 120 000 articles scientifiques ont été publiés depuis 1950 sur la biodisponibilité des contaminants du sol [2], il aura fallu attendre le dernier quart du XXe siècle pour voir la communauté scientifique commencer à en formaliser la théorie [[3], [4]]. Cet effort de formalisation a permis de voir émerger au début du XXIe siècle un consensus au sein de la communauté scientifique, traduit par l’élaboration d’une norme internationale définissant à la fois les éléments théoriques et méthodologiques pour l’évaluation de la biodisponibilité des contaminants dans les sols [5].
Selon les attendus de cette norme, « les effets biologiques ne sont pas liés à la concentration totale d’un contaminant dans le sol ». Une partie du contaminant ne pourra en réalité pas être accessible pour l’organisme. La définition alors donnée pour la biodisponibilité est le « degré auquel des substances chimiques présentes dans le sol peuvent être absorbées ou métabolisées par un récepteur humain ou écologique, ou être disponibles pour une interaction avec les systèmes biologiques ». Cette biodisponibilité pourra être caractérisée par des mesures chimiques ou biologiques. Aujourd’hui, cette théorie reste celle qui prévaut dans la communauté scientifique, malgré quelques améliorations et révisions ponctuelles [6]. Elle est d’ailleurs à la base du principe d’évaluation des risques de pollution récemment proposé dans le projet de directive européenne sur la surveillance et la résilience des sols [7].
Références
1 | Boulaine J, Histoire des pédologues et de la science des sols, Inra, 1988.
2 | Chen HY et al., “A 50-year systemic review of bioavailability application in soil environmental criteria and risk assessment”, Environmental Pollution, 2023, 335 :122272.
3 | Juste C, « Appréciation de la mobilité et de la biodisponibilité des éléments traces du sol », Science du sol, 1988, 26 :103-12.
4 | Peijnenburg WJ et al., “A conceptual framework for implementation of bioavailability of metals for environmental management purposes”, Ecotoxicology and environmental safety, 1997, 37 :163-72.
5 | « Qualité du sol : lignes directrices pour la sélection et l’application des méthodes d’évaluation de la biodisponibilité des contaminants dans le sol et les matériaux du sol », Norme NF EN ISO 17402, Afnor, 2011. Sur boutique.afnor.org
6 | Tusseau-Vuillemin MH et al., Biodisponibles : une histoire entre le vivant et son exposome, ISTE éditions, 2018, vol. 3.
7 | European commission, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Soil Monitoring and Resilience (soil monitoring law)”, 5 juillet 2023.
La biodisponibilité : trois critères à prendre en compte
La disponibilité
Pour pouvoir être biodisponible, un contaminant doit tout d’abord être disponible dans le sol, c’est-à-dire être physiquement et chimiquement accessible à un organisme vivant afin de pouvoir être absorbé par celui-ci. Cette disponibilité dépend de la forme chimique du contaminant (voir l’encadré sur le chrome ci-dessous) ainsi que de sa capacité à s’associer avec la matière organique et les minéraux du sol. Plus cette capacité est forte, plus la disponibilité du contaminant, et par conséquent sa biodisponibilité, sont faibles. Le sol étant un milieu retenant très fortement les contaminants, la fraction disponible d’un contaminant représente le plus souvent une part très minoritaire de sa concentration totale.
Le chrome est principalement présent dans l’environnement sous deux formes chimiques distinctes qui copondent à deux états d’oxydation. Dans sa forme trivalente (CrIII), l’atome de chrome possède trois charge positives. Dans sa forme hexavalente (CrVI), il possède deux charges négatives. Cette différence détermine non seulement la disponibilité du chrome dans le sol, mais également sa toxicité pour les organismes vivants dont l’être humain [1, 2].
Le chrome III
Lorsqu’il est présent sous sa forme trivalente (CrIII), le chrome est assez fortement retenu par les constituants du sol (matière organique et minéraux comme les oxydes de fer) et y est donc relativement peu disponible. De ce fait, CrIII est peu biodisponible pour les organismes vivants qui y sont exposés. Par ailleurs, CrIII est un oligo-élément indispensable en faible quantité pour le métabolisme du sucre dans le corps humain. Sous cette forme, le chrome est faiblement toxique pour l’être humain. Il ne devient toxique qu’à des niveaux élevés d’ingestion [3].
Le chrome VI
En revanche, lorsqu’il est présent sous sa forme hexavalente (CrVI), le chrome est beaucoup plus faiblement retenu par les constituants du sol et y est donc plus fortement disponible. De fait, CrVI est également plus biodisponible pour les organismes vivants qui y sont exposés. Lorsqu’il est ingéré ou inhalé par l’être humain, le chrome sous forme hexavalente peut notamment entraîner une altération de la structure ou du fonctionnement du génome (génotoxicité) ainsi que des cancers (cancérogénicité). Le seuil toxicologique d’exposition de l’être humain au chrome issu des bases de données internationales est plus de cinq fois inférieur pour CrVI relativement à CrIII [3], ce qui signifie que la toxicité de CrVI pour l’être humain est très nettement supérieure à celle de CrIII. Ainsi, le risque de pollution associé à la contamination en chrome d’un sol agricole ne peut pas être évalué correctement si les proportions relatives de CrIII et CrVI ne sont pas connues [4].
Références
1 | Boulvert E, Guérin S, « Expositions au chrome hexavalent, synthèse des données disponibles : sources, émissions, exposition et toxicité pour l’homme », Synthèse des données disponibles, Ineris, 10 janvier 2020. Sur ineris.fr
2 | Choppala G et al., “Chromium contamination and its risk management in complex environmental settings”, Advances in Agronomy, 2013, 120 :129-72.
3 | Wullenweber A et al., “Ressources for global risk assessment : the International Toxicity Estimates for Risk (ITER) and Risk Information Exchange (RiskIE) databases”, Toxicology and Applied Pharmacology, 2008, 233 :45-53.
4 | Leblanc JC, Sirot V, « Étude de l’alimentation totale française 2 (EAT2) – Tome 1 : Contaminants inorganiques, minéraux, polluants organiques persistants, mycotoxines, phyto-estrogènes », Rapport d’expertise, Anses, 2011.
Pour quantifier cette disponibilité, des mesures chimiques sont réalisées sur des échantillons de sol à l’aide de protocoles standardisés consistant à extraire le contaminant à l’aide d’agents chimiques divers (solutions salines, acides, solvants organiques, molécules organiques se liant au contaminant...) avec plus ou moins de force. Une quantité importante de contaminant extraite en utilisant un agent chimique ayant un faible pouvoir extractant va traduire une disponibilité élevée du contaminant dans le sol.

Être absorbé par un organisme vivant
Présent dans le sol sous une forme disponible, un contaminant deviendra biodisponible s’il est effectivement absorbé par un organisme vivant. On parle de « biodisponibilité environnementale ». Or cela dépend aussi de la capacité de l’organisme à modifier cette disponibilité. Les organismes vivants peuvent en effet changer les propriétés physiques, physico-chimiques et biologiques du sol qu’ils prospectent. C’est par exemple le cas des vers de terre qui, en diminuant l’acidité et en augmentant la concentration en matière organique soluble du sol qu’ils ingèrent puis rejettent dans leur déjection, modifient la disponibilité des éléments minéraux présents en faible concentration (appelés éléments traces comme le cuivre, le zinc, l’arsenic, le cadmium ou encore le plomb) [6]. Autre exemple : les racines des plantes, par l’intermédiaire des substances chimiques qu’elles sécrètent, sont également capables de modifier profondément les propriétés du petit volume de sol qui s’étend sur quelques centaines de micromètres à quelques millimètres autour d’elles et qu’on appelle la rhizosphère [7]. La disponibilité des contaminants mesurée dans cette rhizosphère peut ainsi être très différente de celle mesurée dans le reste du sol non influencé par les activités racinaires [8, 9]. La disponibilité des contaminants du sol peut également évoluer dans le temps, en lien avec l’évolution de ses propriétés au fil des variations saisonnières du climat ou du fait de certaines pratiques agricoles.
Enfin, la biodisponibilité environnementale du contaminant dépend aussi de la durée d’exposition de l’organisme exposé ou encore de sa capacité à réguler biologiquement l’absorption du contaminant. Certains organismes sont considérés comme des « accumulateurs » et stockent certains contaminants dans leurs tissus en très grande quantité. En outre, les organismes peuvent progressivement s’adapter à cette exposition en mettant en œuvre des mécanismes d’excrétion qui tendent à diminuer la bioaccumulation du contaminant [10].
Depuis près de 150 ans, la pulvérisation de cuivre sur les plantes (dont une partie se retrouve dans les sols) est largement pratiquée en agriculture, et particulièrement en agriculture biologique. Ses principaux usages sont la lutte contre le mildiou, une maladie due à un champignon réduisant fortement le rendement de la vigne et de la pomme de terre et contre la tavelure du pommier [1]. Mais ces apports de cuivre ont été reconnus comme ayant un impact négatif sur le fonctionnement et les organismes vivants du sol et l’Union européenne a limité son utilisation à une dose maximale d’apport de 4 kg/ha/an en moyenne sur sept ans [1].
Une équipe française a récemment étudié la littérature scientifique pour évaluer la pertinence environnementale de cette dose maximale [2]. Ils en ont conclu que les seuils de toxicité du cuivre pour les différents organismes du sol étaient au moins cinquante fois supérieurs à la dose d’apport de 4 kg/ha/an et donc que cette dose maximale d’apport autorisé était suffisamment protectrice. Cette conclusion a cependant été remise en question par une autre équipe française qui a appuyé son argumentation sur plusieurs principes de la théorie de la biodisponibilité [3]. Ils ont premièrement relevé que les seuils toxicologiques issus de la littérature avaient été déterminés à partir de sols initialement non contaminés en cuivre, alors que la majorité des sols viticoles européens sont historiquement contaminés [4]. La vitesse d’apparition d’une toxicité due au cuivre nouvellement apporté et s’ajoutant à celui historiquement accumulé dans la plupart des sols viticoles reste donc incertaine. Il a ensuite été souligné que le faible nombre d’études analysées (une vingtaine) ne pouvait pas être représentatif de la diversité des propriétés des sols viticoles européens et par conséquent de la gamme de disponibilité du cuivre réellement observée sur le terrain. Il a enfin été clairement montré dans la littérature que si la disponibilité du cuivre tendait à être maximale dans les sols les plus acides et pauvres en matières organiques, elle était très largement modifiée dans la rhizosphère des plantes en fonction de l’espèce végétale cultivée [5, 6].
Ce débat a conduit à conclure que la dose maximale d’apport de 4 kg/ha/an ne présentait vraisemblablement « pas de risque à court-terme dans certains vignobles » peu ou pas contaminés, « mais pourrait constituer une menace dès à présent dans les vignobles les plus vulnérables » présentant une forte accumulation historique de cuivre, des conditions spécifiques d’acidité et de matière organique des sols [7] ou encore lors de l’implantation de nouvelles cultures capables de modifier la disponibilité initiale de cuivre accumulé. Ainsi conclu, ce débat illustre l’importance de la prise en compte des principes de la théorie de la biodisponibilité dans l’évaluation des risques de pollution des sols agricoles.
Références
1 | European commission, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Soil Monitoring and Resilience (soil monitoring law)”, 5 juillet 2023.
2 | Karimi B et al., « La biodiversité des sols est-elle impactée par l’apport de cuivre ou son accumulation dans les sols vignes ? : synthèse des connaissances scientifiques », Étude et Gestion des Sols, 2021, 28 :71-92.
3 | Imfeld G et al., « Prise en compte du stockage et de la disponibilité du cuivre dans les sols viticoles pour en évaluer son écotoxicité : commentaires sur l’article de Karimi et al. (2021) », Étude et Gestion des Sols, 2021, 28 :181-5.
4 | Ballabio C et al., “Copper distribution in European top soils : an assessment based on LUCAS soil survey”, Science of The Total Environment, 2018, 636 :282-98.
5 | Brunetto G et al., “Copper accumulation in vineyard soils : rhizosphere processes and agronomic practices to limit its toxicity”, Chemosphere, 2016, 162 :293-307.
6 | Michaud AM et al., “Copper uptake and phytotoxicity as assessed in situ for durum wheat (Triticum turgidum durum L.) cultivated in Cu-contaminated, former vineyard soils”, Plant and Soil, 2007, 298 :99-111.
7 | Karimi B et al., « Réponse aux commentaires de Imfeld et al. (2021) sur l’article de Karimi et al. (2021) », Étude et Gestion des Sols, 2021, 28 :187-90.
Bioaccumulation et toxicité
Une fois prélevé par l’organisme, le contaminant peut s’accumuler dans les tissus, pouvant entraîner un effet toxique s’il dépasse un seuil de concentration tolérable par l’organisme. C’est ce qu’on appelle la « biodisponibilité toxicologique ». Toutefois, tous les organismes vivants disposent de mécanismes physiologiques de tolérance à la bioaccumulation. Les vers de terre, par exemple, stockent les éléments traces dans des cellules spécifiques de leur intestin où des molécules comme les métallothionéines s’y associent et les empêchent d’exprimer un effet toxique [11]. Pour un organisme donné, les seuils de tolérance varient grandement en fonction de la nature du contaminant et des mécanismes à l’origine de sa toxicité. Ces seuils sont également très variables entre organismes (entre deux espèces, voire entre deux variétés d’une même espèce), ainsi que pour un organisme donné en fonction de son état de santé ou de nutrition. Un organisme déjà affaibli, par exemple par un manque d’eau ou de nutriments, sera généralement moins tolérant à la bioaccumulation.
On comprend dès lors que la biodisponibilité (environnementale ou toxicologique) peut être très différente d’un organisme à un autre, ce qu’une simple mesure physico-chimique de disponibilité réalisée sur le sol ne permettra pas de rendre compte. C’est pourquoi il est préférable de caractériser expérimentalement la biodisponibilité à l’aide de méthodes biologiques mesurant la bioaccumulation du contaminant (par exemple sa concentration dans l’organisme) ou sa toxicité sur l’organisme exposé (par exemple en comparant la croissance de cet organisme à celle d’un témoin non exposé). La communauté scientifique fait cependant face aujourd’hui à la difficulté de développer des méthodes permettant de caractériser la biodisponibilité d’une diversité toujours plus grande de contaminants auxquels est exposée une grande diversité d’organismes vivants.
La biodisponibilité est donc une notion qui fait appel à une large diversité de mécanismes physico-chimiques et biologiques. La maîtrise de cette notion est essentielle pour distinguer parmi toutes les contaminations du sol celles qui constituent une pollution et se donner les moyens d’appréhender de façon pragmatique et efficace les problématiques les plus préoccupantes en matière de santé humaine et d’impacts environnementaux.
1 | « Qualité du sol : lignes directrices pour la sélection et l’application des méthodes d’évaluation de la biodisponibilité des contaminants dans le sol et les matériaux du sol », Norme NF EN ISO 17402, Afnor, 2011. Sur afnor.org
2 | Bile C et al., « Bouclage des cycles de nutriments », Dictionnaire d’agroécologie, 15 avril 2019. Sur dicoagroecologie.fr
3 | Sutton MA et al., “Too much of a good thing”, Nature, 2011, 472 :159-61.
4 | Elster J, Bennett E, “Phosphorus cycle : a broken biogeochemical cycle”, Nature, 2011, 478 :29-31.
5 | “Closing the plastics loop”, Nature sustainability, 2018, 1 :205.
6 | Sizmur T, Richardson J, “Earthworms accelerate the biogeochemical cycling of potentially toxic elements : results of a metaanalysis”, Soil Biology and Biochemistry, 2020, 148 :107865.
7 | Hinsinger P et al., “Rhizosphere : biophysics, biogeochemistry and ecological relevance”, Plant and Soil, 2009, 321 :117-52.
8 | Miller EL et al., “Root uptake of pharmaceuticals and personal care product ingredients”, Environmental Science & Technology, 2016, 50 :525-41.
9 | Wenzel WW et al., “Trace element biogeochemistry in the rhizosphere”, in Dynamics and bioavailability of heavy metals in the root zone, CRS Press, 2011, 147-81.
10 | Jager T et al., “General unified threshold model of survival : a toxicokinetic-toxicodynamic framework for ecotoxicology”, Environmental Science & Technology, 2011, 45 :2529-40.
11 | Richardson JB et al., “Synthesis of earthworm trace metal uptake and bioaccumulation data : role of soil concentration, earthworm ecophysiology, and experimental design”, Environmental Pollution, 2020, 262 :114126.
Publié dans le n° 347 de la revue
Partager cet article
Les auteurs

Matthieu Bravin
Matthieu Bravin est chercheur au sein de l’unité Recyclage et risque du Centre de coopération internationale en (…)
Plus d'informations
Pascal Pandard
Ingénieur à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris). Il est écotoxicologue et (…)
Plus d'informationsEnvironnement et biodiversité

Ne pas confondre contamination et pollution
Le 25 avril 2024
Tour d’horizon des contaminants présents dans les sols agricoles
Le 22 avril 2024
Pollution des sols agricoles, quel est l’état des connaissances ?
Le 21 janvier 2024
Une étude sur la diminution des populations d’oiseaux en Europe
Le 4 novembre 2023Communiqués de l'AFIS